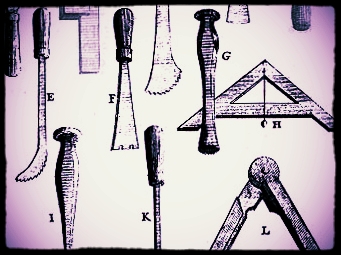« Et si j’écris en français, qui est la langue de mon pays, plutôt qu’en latin, qui est celle de mes précepteurs, c’est à cause que j’espère que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu’aux livres anciens. Et pour ceux qui joignent le bon sens avec l’étude, lesquels seuls je souhaite pour mes juges, ils ne seront point je m’assure si partiaux pour le latin, qu’ils refusent d’entendre mes raisons pource que je les explique en langue vulgaire. » Descartes, Discours de la méthode, Sixième Partie.
Publié en 1637 – soit quatre ans avant les Méditations métaphysiques qui seront elles écrites en latin –, Le Discours de la méthode s’adresse moins aux savants qu’aux hommes de bon sens. Cette oeuvre est comme la biographie intellectuelle de Descartes : le philosophe y relate l’histoire de son esprit, ou « comment Descartes est devenu cartésien ». Aussi le Discours commencera-t-il par raconter les déceptions et les doutes du jeune Descartes, qui fut l’élève peu ordinaire du Collège de la Flèche avant de parcourir le grand livre du monde. Mais, si l’histoire de Descartes mérite d’être lue, c’est parce qu’elle est d’abord celle d’un esprit et qu’elle s’adresse ainsi à tous les esprits. Il ne faut donc pas s’y tromper : le « je » autobiographique n’a d’intérêt que parce qu’il engendre un « je » philosophe.
La vérité est universelle et intemporelle, mais la découverte de la vérité est toujours personnelle et particulière : rien n’est moins désincarné que la pensée et rien n’est moins abstrait que le chemin qu’elle doit accomplir pour se délivrer de l’erreur et du préjugé. La recherche de la vérité demeure une tâche que personne ne peut accomplir à notre place, ce qui ne signifie pas que nous n’avons pas besoin d’y être invités par des esprits comme celui de Descartes.
Note sur le cours publié
Cet atelier de lecture, animé durant l'année scolaire 2012-2013 de l'Université Conventionnelle, comporte 9 séances. On trouvera ici l'ensemble des notices et des textes étudiés. Les podcasts des séances sont également disponibles sur notre compte Soundcloud sous forme de liste de lecture.